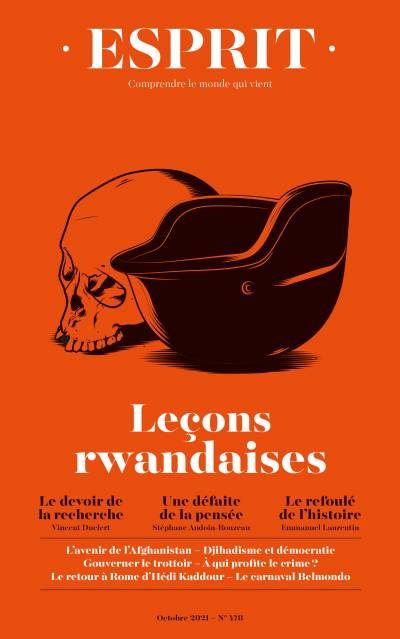« Raconter, c’est tromper et réparer »
Palme d’or évidente aux yeux de nombreux festivaliers, Drive My Car a décroché un étrange Prix du scénario cette année au Festival de Cannes. Hamaguchi Ryusuke, en compétition déjà en 2018 avec Asako 1 & 2, s’est fait connaître en France avec Senses en 2015. Dans Drive My Car, l’interprétation, la direction d’acteur et la mise en scène témoignent de l’immense maîtrise d’un cinéaste déjà au sommet de son art à 42 ans. Pour la revue Esprit, qui a publié en avril 2019 sa leçon de cinéma (« Que faire voir ? »), il est revenu sur la fabrication de ce bouleversant film sur le deuil, la rencontre et l’apaisement.
Comment ce projet est-il né ? Il succède de très peu à Contes du hasard et autres fantaisies (2020), Grand Prix au festival de Berlin. Est-ce que les deux projets se sont chevauchés ?
En 2018, après la sortie de Asako 1 & 2, mon producteur Yamamoto est venu avec un projet sous le bras, une nouvelle de Murakami. Il se trouve que cette nouvelle ne me parlait pas immédiatement. Mais je lui ai dit que j’avais lu une nouvelle de Murakami, Drive My Car, dans laquelle il y avait des motifs, des questionnements qui m’intéressaient, que j’avais déjà abordés dans mes précédents films : la voiture (un espace clos dans lequel un échange intime peut se dérouler), l’idée du déplacement et du trajet, et des personnages d’acteurs ou de metteurs en scène. En 2019, j’ai commencé les démarches pour obtenir les droits auprès de Murakami, et à écrire le scénario. Parallèlement, j’avançais dans Contes du hasard et autres fantaisies. Courant 2019, j’ai tourné deux des trois épisodes des Contes… Nous devions débuter le tournage de Drive My Car en mars 2020. Nous avons tourné toute la première partie du film, le prologue à Tokyo. La Covid s’est ensuite beaucoup diffusée au Japon. Il a été question que Tokyo soit mis en état d’urgence. Nous avons été obligés de nous interrompre. Nous étions censés tourner à Busan, en Corée. Or les déplacements à l’étranger sont devenus très compliqués. Le tournage a été interrompu pendant huit mois. Il a fallu trouver une solution de tournage. Et, dans cet intervalle, j’ai tourné le troisième épisode des Contes… En novembre 2020, nous avons pu terminer le tournage de Drive My Car. Excepté pour la petite séquence de fin, qui a été tournée en mars 2021, soit un an après le début du tournage du film.
Kafuku, le personnage principal, qui perd sa femme durant le prologue du film, est invité à Hiroshima pour monter Oncle Vania de Tchekhov. Il y rencontre une jeune femme, Misaki, qui lui est assignée comme chauffeur. Aviez-vous prévu de tourner cette rencontre avec la jeune femme, qui le conduit quotidiennement à travers les paysages de la mer intérieure, à Hiroshima ?
Non.
La trajectoire du héros avec Misaki, de Tokyo à Hiroshima puis à Hokkaido, le conduit à revisiter des souvenirs traumatiques et à aller à la rencontre des souffrances de son interlocutrice dans la voiture, comme à la rencontre des catastrophes collectives traversées par le Japon. Avez-vous souhaité associer les catastrophes individuelles et celles de l’histoire du Japon contemporain ?
Quand le producteur m’a parlé pour la première fois de Hiroshima, qu’il envisageait comme lieu de tournage, je n’ai pas tout de suite été enthousiaste. Cela m’a semblé compliqué parce que le symbole historique est lourd. Et je ne savais pas si je souhaitais que mon film y soit associé. D’autant plus que j’avais déjà traité de la catastrophe de Fukushima dans Asako 1 & 2 et coréalisé une trilogie de documentaires dans la région sinistrée du Tohoku (The Sound of the Waves en 2011, Voices from the Waves. Shinchimachi et Kesennuma en 2012, et Storytellers en 2013). Je craignais qu’on pensât que je faisais toujours la même chose, que je cherchais à aborder les épisodes dramatiques de mon pays. Donc j’étais assez réticent. Mais je suis allé voir à quoi ressemblait la ville. Et la lumière sur cette mer intérieure est magnifique. D’un point de vue architectural, toute la zone autour du Mémorial de la paix me semblait très adaptée au film. Par ailleurs, c’est une ville qui a été rasée et reconstruite. Cette histoire est encore très présente dans la ville. Or les protagonistes de Drive My Car subissent une perte importante et cheminent vers la reconstruction d’eux-mêmes. Il y avait donc un parallèle possible. Ce qui importe pour moi, c’est que ce film interroge notre responsabilité dans ce qui nous arrive. Et cette interrogation des personnages a un lien avec Hiroshima. En effet, la ville a été victime de la bombe atomique, mais le Japon a aussi beaucoup attaqué les pays voisins pendant la guerre. De ce point de vue, il y avait vraiment un sens à tourner à Hiroshima.
Drive My Car est centré sur cette voiture autour de laquelle se déploient les quatre temps du film : un premier temps durant lequel elle abrite les conversations du couple sur leurs récits (puisque Kafuku est metteur en scène et son épouse scénariste), un deuxième temps durant lequel Kafuku écoute les cassettes enregistrées par sa femme décédée pour lui faire répéter ses rôles, un troisième durant lequel la Saab rouge accueille l’échange et les récits de Misaki et Kafuku, et enfin un quatrième (épilogue), dont nous ne dirons rien si ce n’est qu’il ouvre vers une autre destinée pour cette voiture. Cet espace d’écoute est assez parallèle à celui que vous créez, avec votre coréalisateur Ko Sakai, dans les séquences d’entretiens avec des survivants du tsunami en 2011 qui composent votre trilogie documentaire (sans compter que les entretiens étaient entrecoupés de brèves scènes de déplacement en voiture des cinéastes). Vous tourniez ces entretiens avec deux dispositifs de prise de vue : interlocuteurs face à face en décalé, de sorte que chacun regarde la caméra, ou de biais, l’interlocuteur écoutant de dos en amorce de plan. Vous disiez à l’époque que vous cherchiez à créer un espace d’écoute et de parole (kiki-gatari) capable d’apaiser vos interlocuteurs1.
Effectivement, dans ces documentaires que j’ai tournés avec Ko Sakai après la catastrophe de 2011, nous avons beaucoup tourné frontalement. Depuis Passion (2008) et The Depths (2010), mes premiers longs métrages de fiction, je me suis dit qu’en tournant face caméra, j’accéderais à quelque chose de plus puissant en termes de jeu. La caméra enregistre ce jeu pleinement de face, avec une plus petite distance entre l’objectif et ce qui se joue. Placer la caméra face au sujet, c’est ce que j’ai commencé à faire dans Intimacies (2012) et ce que nous avons pleinement exploité dans les documentaires. Par conséquent, un vrai parcours s’est dessiné de Passion à Intimacies puis aux documentaires, qui a confirmé au fur et à mesure une intuition.
Accéder à l’intimité des personnages dans cet espace clos qu’est la voiture en mouvement était d’autant plus important qu’il fallait rendre compte du développement de leur écoute réciproque. À l’origine, Kafuku est un homme esseulé dans son couple, éloigné de sa femme avant même de la perdre. Cet éloignement vient évidemment de la mort de leur fille. Cette disparition, ils l’ont surmontée chacun de leur côté en s’investissant davantage dans la création artistique, mais en construisant chacun des récits de son côté. Oto décède et arrive Misaki. Son rôle consiste justement à écouter Kafuku. S’il y a une chose que j’ai vraiment apprise en réalisant des documentaires, c’est que pour parler, les gens doivent se sentir écoutés. Ce qui permet la libération de la parole, c’est de pouvoir être entendu.
Vous prononcez souvent le mot de monogatari à propos de ce film. Est-ce que vous le concevez comme une sorte de prolongement de cette forme littéraire liée à la tradition orale, attachée au récit fictionnel ou « fictionnalisé » d’une histoire qui dérive parfois d’un événement historique (comme le Dit du Genji) ?
Murakami dit de lui-même que, dans une vie antérieure, il racontait probablement des histoires dans une grotte. Il considère que son travail, c’est de raconter des histoires (monogatari). En littérature, il y a des livres qui racontent des histoires et d’autres pas. Je crois que c’est ce qui m’intéresse beaucoup chez lui. Je ressens une continuité entre son travail et le mien. Littéralement, mono veut dire « l’objet, la chose », et kataru veut dire « raconter », mais aussi « duper, tromper ». Donc monogatari, c’est une façon de raconter ou de tromper quelque chose en lui donnant une autre forme. On peut donc aussi traduire monogatari par « récit ». Quand j’ai réalisé des documentaires, cela a été une révélation pour moi. Les victimes du tsunami que je rencontrais me disaient toutes la même chose : nous n’arrivons pas à croire à ce qui nous arrive, nous avons l’impression de vivre dans un cauchemar. Le fait de raconter ce qu’elles ont vécu leur permet de se réapproprier leur propre réalité, de se remettre en phase avec ce qu’elles ont subi. Personne ne s’attend à ce que sa vie soit soudain engloutie. Le décalage entre la vie qu’on menait et la vie qu’on se retrouve à mener peut être terrible. Cet écart peut être comblé par l’histoire. Ainsi, monogatari est une notion importante pour moi. C’est ce que font les personnages Kafuku et Misaki. À la fin du film, ils racontent leur histoire. Leur échange est presque trop explicite, mais c’est un processus nécessaire.
La double scène finale d’apaisement (le monologue de Sonia, dans la bouche de Misaki puis sur scène) témoigne du pouvoir de réparation de l’histoire, et du film lui-même.
Oui, j’ai réalisé le film dans cet esprit.
Propos recueillis par Élise Domenach à Cannes, le 14 mai 2021.
Remerciements à Léa Le Dimna, interprète.
- 1. Voir Élise Domenach, « Entretien avec Ko Sakai et Ryusuke Hamaguchi. Écouter la voix des morts », Fukushima en cinéma. Voix du cinéma japonais, Tokyo, Tokyo University Press, 2015.