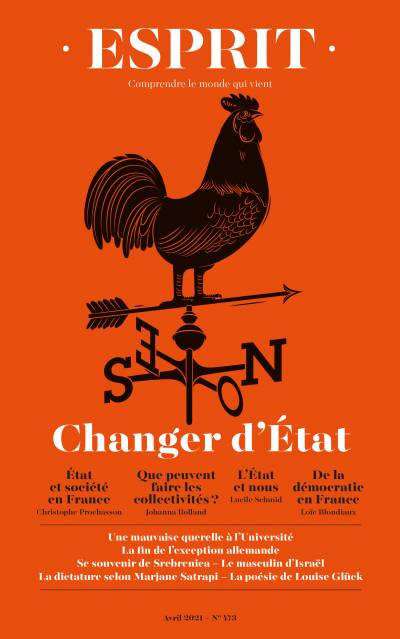Rescapée du goulag chinois de Gulbahar Haitiwaji et Rozenn Morgat
Lire le récit de Gulbahar Haitiwaji, c’est à la fois comprendre la mécanique du quotidien d’un système concentrationnaire moderne, et prendre la mesure de l’ampleur et de la sophistication du génocide que tentent les dirigeants chinois contre le peuple ouïgour.
Après les témoignages d’Alexandre Soljenitsyne ou Varlam Chalamov sur le goulag stalinien, Simone Veil, Elie Wiesel, Jorge Semprún et tant d’autres sur les camps nazis, Gulbahar Haitiwaji apporte un nouveau chapitre au récit universel de l’enfermement.
Son témoignage sur les prisons chinoises et les camps de rééducation du Xinjiang stupéfait par la constance de l’imagination des bourreaux. Les techniques chinoises de ce début de siècle n’ont d’évidence rien à envier ni rien à apprendre de celles que rapportent les témoins revenus de camps. Il y a comme une sorte d’universel de la torture pour ceux dont l’objectif n’est pas (seulement) de tuer, mais (aussi) plus subtilement d’anéantir. La privation de sommeil et de nourriture, la perte de tout repère temporel jusqu’à ne plus savoir ce qu’est une heure, confondre les jours et se perdre dans le compte du temps constituent les bases de la déconstruction des individus.
Ce qui paraît un ajout assez spécifiquement chinois, c’est la tentative d’endoctrinement : remplacer toute mémoire par des chants patriotiques et des morceaux de phrases sans cesse répétés, à la gloire du régime et de son président. Il y a aussi la déchéance physique, l’humiliation des seaux au milieu de cellules surpeuplées ou l’inspection régulière des corps nus. Les planches sur lesquelles Gulbahar Haitiwaji et ses codétenues cherchent le sommeil rappellent les châlits d’autres prisonniers et, chaque hiver, les détenues avaient cette même hantise du froid qui marque les corps et les esprits. Gulbahar Haitiwaji raconte aussi la condition particulière des femmes et ces séances de vaccination contre « la grippe » qui font cesser les règles et constituent très probablement un programme de stérilisation systématique de la minorité ouïgoure. Les tortionnaires sont également universellement portés sur les chiffres : numéros de cellules et, évidemment, des prisonniers. Gulbahar Haitiwaji était la détenue no 9, cellule no 202.
Elle décrit enfin ces techniques dont tous les bourreaux semblent avoir l’ultime maîtrise, ces petits riens du quotidien qui font vaciller dans le désespoir absolu, la vision de sa propre mort jusqu’à l’espérance inconsidérée d’un retour à la vie d’avant.
L’autre constance est l’imagination des victimes pour tenter de vaincre le mal. Gulbahar Haitiwaji raconte à son retour des scènes qui semblent déjà vécues par d’autres, dans les latrines de Buchenwald ou d’ailleurs. Face à un miroir, entre deux coups de sifflet d’un geôlier, il suffit de l’échange d’un regard, de mains qui s’effleurent, de quelques mots ou de quelques larmes pour transformer de précieuses minutes volées à la surveillance des gardiens en un retour fugace à une humanité perdue.
Le récit de Gulbahar Haitiwaji est aussi ponctué de ces quelques détails qui fixent le récit dans son temps : les geôliers ont désormais des cartes magnétiques pour ouvrir les portes, les cellules sont équipées de caméras qui suivent automatiquement le mouvement des détenues et lors des interrogatoires, les agents du renseignement chinois surveillent Facebook, TikTok ou Snapchat.
Lire le récit de Gulbahar Haitiwaji, c’est à la fois sombrer dans l’universalité du mal, comprendre la mécanique du quotidien d’un système concentrationnaire moderne et prendre la mesure de l’ampleur et de la sophistication du génocide que tentent les dirigeants chinois contre le peuple ouïgour.